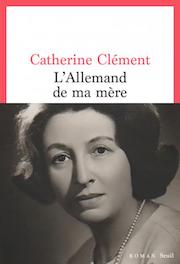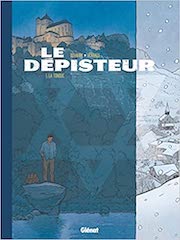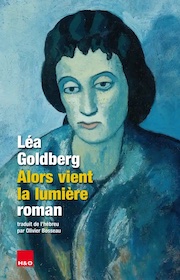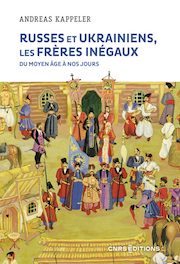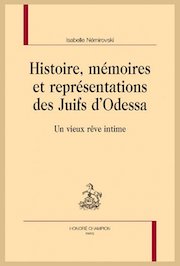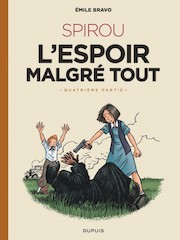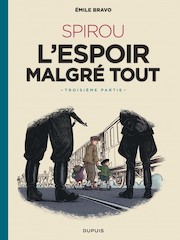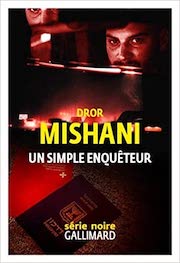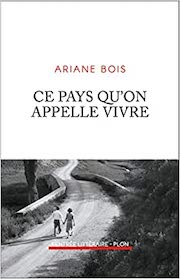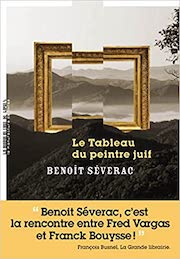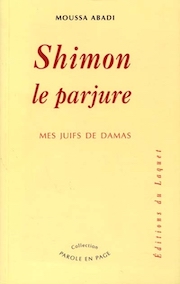L’ ALLEMAND DE MA MERE
Catherine CLÉMENT
Seuil ,205 pages
Qui est le docteur Schütz, juif allemand réfugié à Paris, à qui la mère de la narratrice, jeune pharmacienne, vient en aide ? Quelle est la véritable identité de ce médecin qui se portera au secours de la famille de l’auteure durant toute la guerre ?
L’armée d’Hitler occupe la moitié du pays et les lois anti-juives se durcissent. La jeune mère et les siens doivent se cacher ; ils se réfugient dans le Maine-et-Loire, vers Saumur.
A l’heure de la Libération, tous n’auront pas la vie sauve. L’attente commence boulevard Raspail devant le Lutetia pour la jeune femme enceinte, accompagnée de sa fille.
Catherine Clément nous livre un récit intime, dépeignant ses parents qui « excepté leur âge et leurs études, n’avaient rien en commun », elle juive et lui issu d’une famille catholique. En contrepoint des souvenirs de sa petite enfance, la chronique historique se déroule, implacable – les décrets des nazis, la collaboration de Vichy, la traque des Juifs et le zèle de certains préfets, la délation au village, les assassinats de masse ; mais aussi la protection par des voisins, des sœurs au couvent…
Une œuvre de mémoire, sensible et précise, et d’histoire pour un rappel brut des faits.
LE DEPISTEUR
Antoine Ozanam (Scénario) – Marco Venanzi (Dessin)
GLÉNAT, 56 pages
La France dans les années 50 , la guerre est terminée mais la mission de Samuel ne fait que commencer.
C’est un dépisteur qui sillonne inlassablement la campagne français, c’est un ancien scout juif qui recherche les enfants cachés pendant la guerre dans des familles d’accueil
On le retrouve dans le Lot sur les traces d’une fillette qui avait un an en 1942, la famille qu’il recherche a été dénoncée pendant l’occupation.Aux dires d’un paysan tout le monde a été exécuté, mais personne ne se souvient de l’enfant caché.
Ce sont des rencontres fortuites qui guident les pas de Samuel et son propre passé mais tout le monde semble avoir quelque chose à cacher…
Dans ce premier tome qui nous laisse …. sur l’envie de connaître très vite la suite on se rend compte que tous les secrets ne sont pas bons à déterrer.
Bonne lecture.
ALORS VINT LA LUMIERE
Lea GOLDBERG
H et O, 254pages
(première édition en 1946)
Lea Goldberg est très populaire en Israël ; elle fait partie des auteurs de poésie et de livres pour la jeunesse. Ce roman réédité fut le premier roman écrit par une femme, édité en Israël. Suivi d’une courte biographie écrite par Olivier Bosseau, on y sent l’influence de la littérature russe, de Tchékov en particulier. Le personnage principal en est Nora, reflet de l’auteure.
Nora est en vacances dans la petite ville de son enfance, après un an d’études d’archéologie à l’université de Berlin. Elle y retrouve sa famille, ses relations, mais aussi l’atmosphère étouffante qu’elle avait fuie. Un personnage mystérieux, arrivé d’Amérique, ami de son père, fait son apparition ; Nora croit trouver en lui l’amour.
C’est en quelque sorte une vision romanesque de sa propre vie qui est mise en scène, bien que Lea Goldberg ait toujours refusé de parler d’autobiographie. Ce roman porte la marque de son temps, l’écriture est un peu datée, mais Nora, ses doutes, sa naïveté, sa fraîcheur, son goût pour la vie nous touchent par leur intemporalité.
RUSSES ET UKRAINIENS, LES FRERES INEGAUX du Moyen Age à nos jours
Andreas KAPPELER
CNRS éditions, 317 pages
Soirée au Centre Medem le 9 mai avec Denis Eckert (traducteur du livre)
Il est bien difficile de résumer le contenu de cet ouvrage historique, en raison des relations souvent équivoques entretenues par « les frères inégaux ». L’origine ambivalente de ces relations tenait à des problèmes ethniques, religieux, culturels, économiques qui remontent fort loin dans le temps.
Si l’on s’en tient à la période moderne, ce livre nous permet de comprendre que l’Occident a très longtemps ignoré cette partie de l’Europe orientale. Pour une raison simple : l’Ukraine était considérée comme une partie de l’Union soviétique, au même titre que les autres pays satellites, exception faite de la Pologne. Andreas Kappeler rappelle fort justement que les puissances occidentales craignaient le démantèlement de l’URSS (Kohl, Mitterrand et Bush).
De leur côté, les dirigeants russes (Gorbatchev, Eltsine) n’ont jamais envisagé une séparation de fait, même après avoir accordé l’indépendance en 1991 (Gorbatchev était même opposé à l’octroi de l’indépendance à l’Ukraine). Ils ont cru que l’Ukraine resterait dans le giron de la mère Russie. Or, les dirigeants ukrainiens (contrairement à la population) ont d’emblée établi une séparation véritable, un état de droit, une administration…
La population russe n’a jamais compris, encore moins admis cette fracture. En outre, si Poutine a repris le concept d’« empire russe » à son profit ce n’est pas seulement en raison de son passage au KGB : c’est aussi en raison de l’adhésion de la majeure partie de la population russe, unie à l’Ukraine de l’Est par une religion orthodoxe partagée. Les Ukrainiens étaient nommés « les petits Russes ». 2004 marque un tournant dans les relations entre les deux pays : c’est la révolution orange, place Maîdan. 2014 représente la première phase de l’envahissement de l’Ukraine : Poutine met la main sur la Crimée. L’Occident proteste verbalement, sans plus, laissant ainsi croire que l’Ukraine devrait se battre seule… On connaît la suite.
Dans sa conclusion, Kappeler rappelle que l’Ukraine n’a jamais renoncé à sa culture ruthène originelle, c’est-à-dire « la cosaquerie libre et égalitaire », page 278 ; que de son côté, la Russie post-soviétique n’a jamais accepté la perte de sa zone d’influence. Pour la première fois depuis longtemps, l’Ukraine est indépendante et se tourne vers l’Ouest. Il est temps pour les Occidentaux de l’aider à trouver sa place parmi les nations démocratiques. Il est temps pour la Russie de l’accepter.
HISTOIRE, MEMOIRES ET REPRESENTATIONS DES JUIFS D’ODESSA : un vieux rêve intime
Isabelle NÉMIROVSKI
Honoré Champion, 439 pages
Cet ouvrage, dense et exhaustif, retrace la vie de la population odessite, depuis la victoire de Catherine II de Russie sur les Turcs jusqu’à la fin du siècle dernier.
C’est en 1794 que la tsarine fonde la ville, sur les restes d’un village turc : Khadjibeï et de son fortin. Idéalement situé d’un point de vue russe, Odessa représente à la fois le « SUD » si attractif, et l’ouverture sur la mer. Dès l’origine, son éloignement de la capitale a attiré non seulement des Russes, mais aussi des immigrants très divers, lesquels en ont fait une ville cosmopolite. On peut souscrire à l’affirmation de l’auteur en faisant une ville quasi indépendante, voire rétive, dans laquelle règne une tolérance inconnue du monde russe.
Les juifs trouvent là un lieu propice à leurs aspirations de liberté et d’activité, si bien que la population juive grandit régulièrement et monte dans l’échelle sociale. L’apogée de cette réussite se situe à la fin du 19e siècle : les juifs se distinguent dans les banques, dans les arts et la culture : dans l’index figurent des noms très célèbres qui firent la gloire d’Odessa. Tant et si bien que cette ville acquiert progressivement le statut d’un mythe, surtout aux yeux de ceux qui en sont partis !
Ce livre très riche est captivant, même pour les lecteurs qui ne sont pas originaires de la ville : en effet, il retrace le parcours de tous ces juifs qui ont œuvré pour la gloire de leur ville, sans savoir qu’un jour, ils devraient la quitter, pourchassés à la fois par la Russie et par l’Allemagne nazie.
Odessa saura-t-elle se souvenir d’eux ?
SPIROU – L’ESPOIR MALGRÉ TOUT
Quatrième partie : UNE FIN ET UN NOUVEAU DÉPART
ÉMILE BRAVO (Textes et dessins)
DUPUIS, 48 pages
Été 1944, la guerre est entrée dans sa phase finale avec la bataille de Normandie. Fantasio et Spirou assistent à l’explosion du train de soldats allemands (c’est l’écureuil Spip qui a appuyé sur le détonateur !) mais ne peuvent empêcher le départ du dernier convoi de déportés vers l’Est.
Dans Bruxelles en liesse avec l’arrivée des Anglais, c’est aussi l’heure des règlements de comptes : collaborateurs, certains policiers et prêtres délateurs, responsables scouts de la VNV (ligue nationaliste flamande), vrais résistants et résistants de la dernière heure…
Quelques mois plus tard, des déportés reviennent, méconnaissables, comme le directeur de l’hôtel maintenant en ruines. Kassandra, la fiancée de Spirou rescapée des camps, part finalement en Palestine où sera fondé un Etat juif. Felix et Felka ne sont pas revenus d’Auschwitz. (La page de fin reproduit l’impressionnant dernier tableau de Felix Nussman – Le Triomphe de la mort.)
Dans l’épilogue, la vie recommence. Les deux amis repartent à bicyclette vers l’aventure, Fantasio optimiste et blagueur, heureux d’être embauché au sein de nouvelle rédaction du journal et fier d’être proposé pour la Croix de guerre, Spirou plus soucieux quant à l’avenir : « La bête n’est pas morte ».
Ainsi se clôt la série consacrée à la Shoah. La fantaisie est toujours là sous la gravité et le tragique.
Le lecteur pourra se documenter sur des thèmes abordés au fil des volumes : les trois jeunes gens qui ont arrêté le convoi 20 du 19 avril 1943 et permis à des déportés de s’échapper ; le gouvernement en exil et l’attitude controversée de Léopold III ; la question de la colonisation du Congo belge…
SPIROU – L’ESPOIR MALGRÉ TOUT
Troisième partie : UN DÉPART VERS LA FIN
ÉMILE BRAVO (Textes et dessins)
DUPUIS, 112 pages
Belgique, été 1942. Du train en partance vers la Pologne, Spirou parvient à sauter avec ses jeunes protégés, Suzanne et P’tit Louis, qu’il va cacher dans une ferme près de Namur.
Entre Bruxelles et la campagne, allers-retours à moto, vélo, camion de lait, automobile à gazogène, Spirou et Fantasio se dépensent pour aider des enfants juifs, ravitailler dans leur planque leurs amis Felix et Felka, trouver des faux-papiers, passer des armes… Ils poursuivent leurs spectacles de marionnettes (telles les tournées de Jean Doisy, directeur du Journal de Spirou, interdit par les Allemands, qui permettait à des résistants de voyager en Belgique occupée).
Les événements se succèdent au fil des mois : débarquement des Alliés en Afrique du Nord, défaite du Reich à Stalingrad, attentat contre Hitler, gouvernement belge en exil à Londres, débarquement en Normandie…
A la face sombre – tortures en prison, morts, lourds cas de conscience (tuer des collaborateurs, des soldats nazis) – répondent l’espoir toujours présent, les valeurs de fraternité du « code d’honneur », et l’humour, la loufoquerie de Fantasio, les clins d’œil (le peintre René Magritte croisé au marché). Les deux héros, bien incarnés, ressentent empathie, peine, émois amoureux, jalousie.
Le volume laisse le lecteur en plein suspense : Fantasio fera-t-il sauter le train « prioritaire » de déportés juifs vers l’est, qu’il pense être un convoi militaire allemand ?
* Le podcast très éclairant du commissaire de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah au Mémorial, D. Pasamonik, 2023, nous en apprend plus sur l’action des grands résistants belges Jean Doisy et Suzanne Moons (qui ont sauvé des centaines d’enfants juifs), sur les peintres Felix Nussbaum et Felka Platek assassinés à Auschwitz. « Toute la vertu d’É. Bravo est d’allier la fiction et la réalité, le tragique et le léger. Cette œuvre de transmission, qui décrit le processus génocidaire de manière non angoissante, est un support de dialogue pour expliquer la Shoah aux plus jeunes. »
Livres recommandés en mars – avril
UN SIMPLE ENQUÊTEUR
Dror MISHANI
Edition Gallimard
Prix des lecteurs de « ELLE »
Le commissaire Avraham Avraham bien connu des lecteurs (c’est le cinquième de la série) âgé de 44 ans jeune marié de surcroît est las d’enquêter sur des crimes domestiques dont la résolution ne rend service à personne.
Il informe son supérieur de son désir de quitter le commissariat de Holon afin d’être affecté dans une autre unité où il aura des missions plus importantes , ce dernier essaie de l’en dissuader en vantant ses grandes qualités d’enquêteurs mais Avraham reste inflexible
De retour à son bureau deux nouvelles affaires arrivent : il délègue celle qui lui semble la plus banale à une collaboratrice la découverte d’un bébé dans un sac à proximité de l’hôpital
C’est la disparition d’un touriste signalée par le directeur d’un hôtel du front de mer qui va retenir son attention
L’homme détenteur d’un passeport suisse est aussi détenteur d’un passeport israélien mais aussi d’autres identités.
On le retrouve noyé sur la plage, l’implication du Mossad commence à se profiler.
Tout porte à croire que Avraham tient sa grande enquête.
C’est là que se situe le talent de l’auteur et qui nous tient en haleine jusqu’à la fin du roman.
CE PAYS QU’ON APPELLE VIVRE
Ariane BOIS
Plon, 287 pages
Ariane Bois est grand reporter et aussi écrivaine. Dans ce roman, dont l’intrigue est secondaire, elle dresse le tableau de ce que fut la vie quotidienne des juifs apatrides et surtout étrangers enfermés dans le « CAMP DES MILLES » situé non loin d’Aix-en-Provence.
Réservé au départ aux hommes, ce camp « accueillera » aussi des femmes et leurs enfants de tous âges. Les conditions de vie y sont déplorables : administration rigoureuse, servile et sans scrupule, souvent inhumaine ; usine désaffectée à l’hygiène inexistante ; nourriture insuffisante ; inactivité démoralisante, etc…
Environ un millier d’hommes étrangers y survivent de 1939 jusqu’à 1942. Ils tentent d’y mener une vie communautaire basée sur leurs anciennes occupations : les acteurs présentent de courtes pièces de théâtre, les écrivains donnent des conférences très suivies ; les peintres tels Max Ernst sont aussi de la partie. Parmi ces derniers, un jeune satiriste nommé Léo Stein tombe amoureux d’une bénévole, Margot, déléguée d’une association d’entr’aide : en effet, le HICEM, l’OSE, Varian Fry ainsi que des bénévoles régionaux, apportent des secours au camp, et s’efforcent de leur trouver un pays d’accueil.
Le souvenir de ces camps de la honte s’estompe avec le temps. Ce « docu-roman » est le bienvenu.
ancre invisible changer l identifiant ID en ancre_X (x numéro du lien à créer)
LE TABLEAU DU PEINTRE JUIF
Benoît SÉVERAC
MANUFACTURE LIV, 306 pages
Ce roman de Benoît Séverac est captivant.
Fin 1943, début 1944, Eli Trudel, peintre juif, et sa femme, doivent fuir en zone libre puis en Espagne via les réseaux de la Résistance du Sud de la France. Ils n’emportent avec eux que quelques affaires et les tableaux d’Eli.
De nos jours, Stéphane hérite d’un tableau qui est dans la famille depuis la Guerre. Cette aquarelle a été offerte par le peintre juif, Eli Trudel, à son grand-père, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie et celle de sa femme. Stéphane n’a alors plus qu’une obsession : faire reconnaître son grand-père comme « Juste parmi les nations ». Il se rend à Jérusalem et présente la toile aux experts de Yad Vashem. Il est arrêté et placé en garde à vue : l’œuvre aurait été volée.
Relâché et de retour en France, il ne peut pas croire que son grand-père, résistant reconnu, ait pu voler le tableau. Il commence alors une enquête sur les traces d’Eli Trudel.
Au fil des pages, on en apprend beaucoup sur la résistance dans les Cévennes, la Haute Garonne, les filières des passeurs. Stéphane arrive jusqu’en Espagne et apprend ainsi que les juifs étrangers qui avaient réussi à passer la frontière étaient relativement épargnés par Franco qui ne voulait pas déplaire (en 1943) aux Allemands, tout en cherchant à s’assurer des bonnes grâces des Alliés en prévision de l’après-guerre.
On ne peut pas quitter ce roman, on a envie de découvrir ce qu’il s’est passé. Le tableau a-t-il été volé ou spolié ? Qu’est-il arrivé aux époux Trudel ?
Le roman se termine par un coup de théâtre sans doute pas comme on pouvait s’y attendre, et peut être même pas comme on l’aurait souhaité…
SHIMON LE PARJURE : mes juifs de Damas
Moussa ABADI
éd. Du Laquet, 252 pages
Cet émouvant recueil nous raconte la vie des juifs de Damas. Il est difficile de le situer dans le temps. Ce qui est certain, c’est que ces petites aventures drôlatiques ont toutes lieu dans le ghetto. 1950 ?
Sous les yeux du Saint béni-soit-il, on se chamaille, on chaparde, on médit, on s’entr’aide aussi, le tout avec force générosité. Les petites gens sont les héros de ces historiettes qui nous font rire… La misère est omniprésente, mais tous acceptent leur sort. Pas de plainte, pas de larme…
L’auteur, lequel a « abandonné » son cher ghetto pour venir en France, fait revivre avec tendresse le Damas de son enfance, la nostalgie au cœur. A la manière d’un grand conteur, il nous fait aimer cette population pieuse, laborieuse, pleine d’humour et d’une grande sagesse.
Très touchant recueil de nouvelles.
Nos sélections récentes
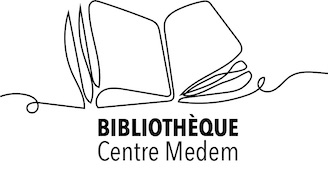
Et aussi les plus anciennes sélections de la bibliothèque