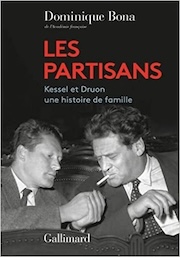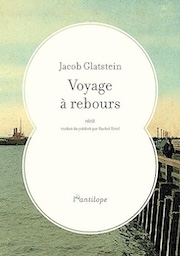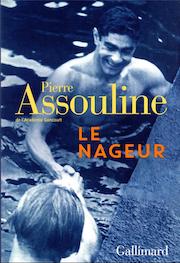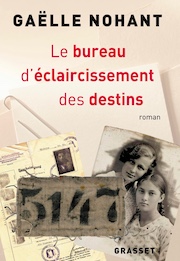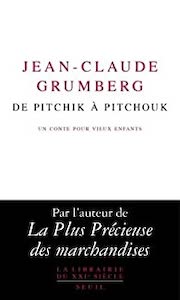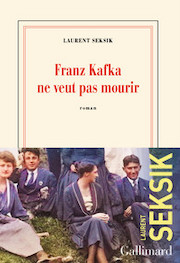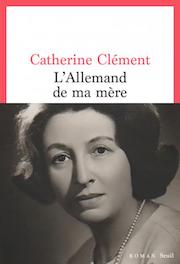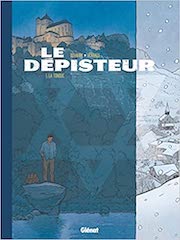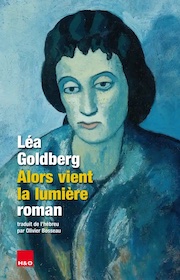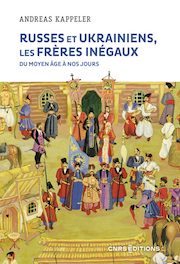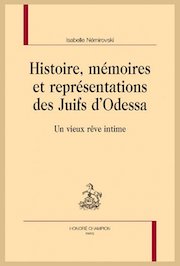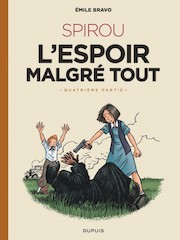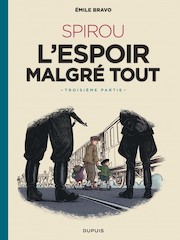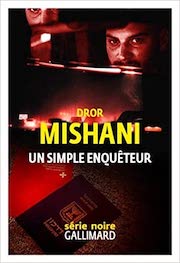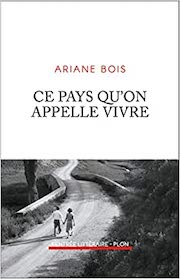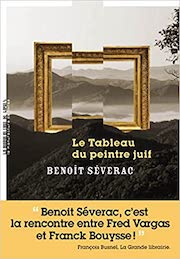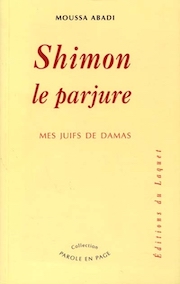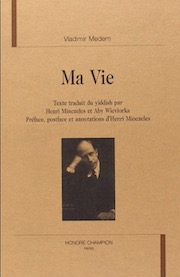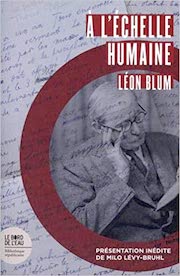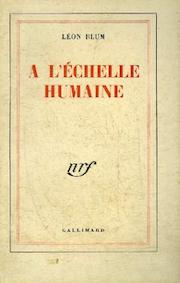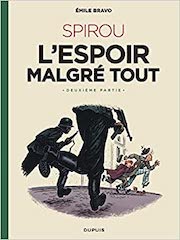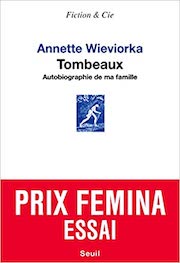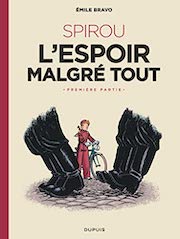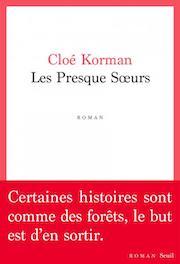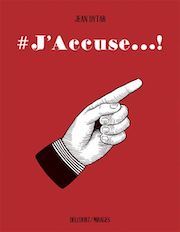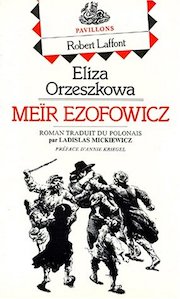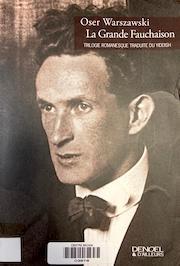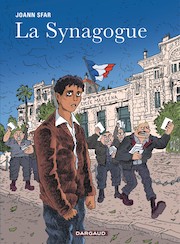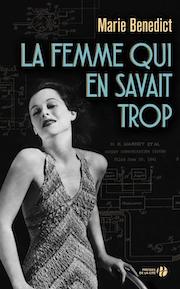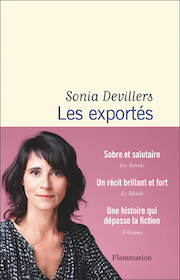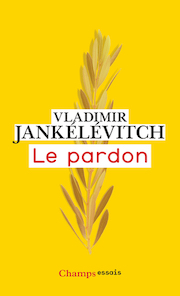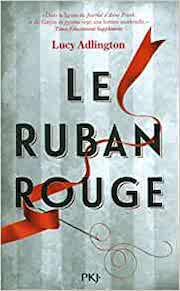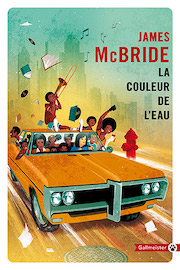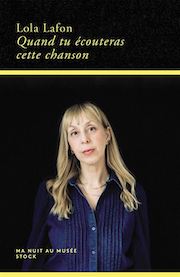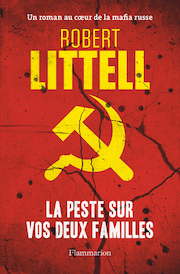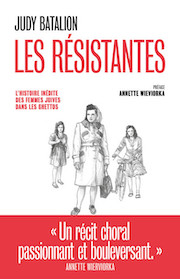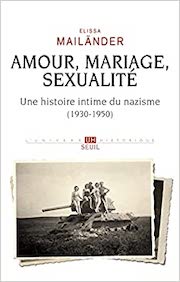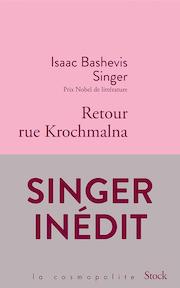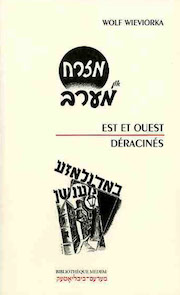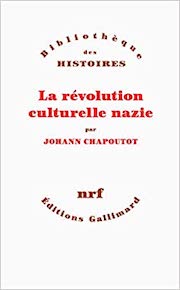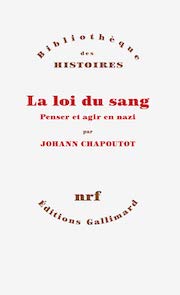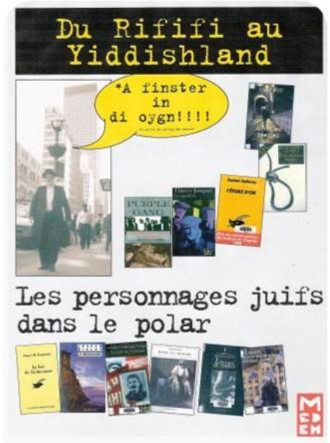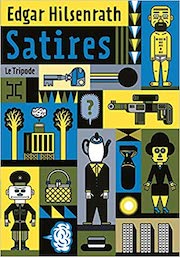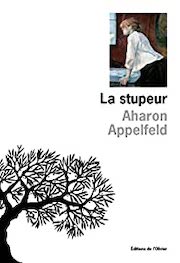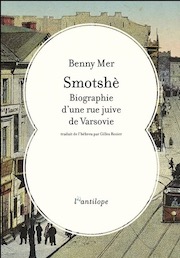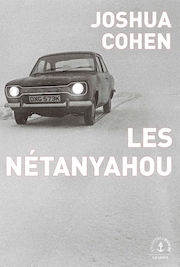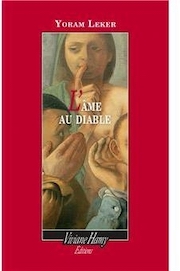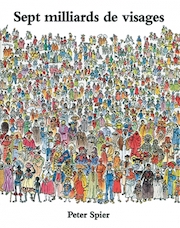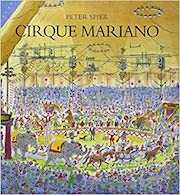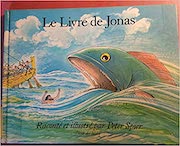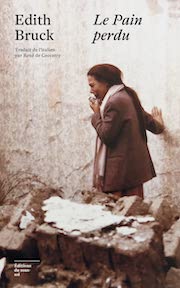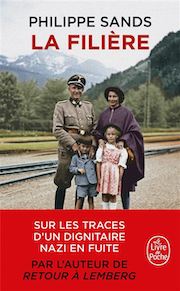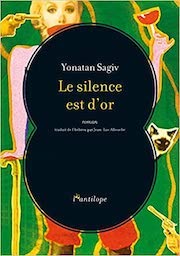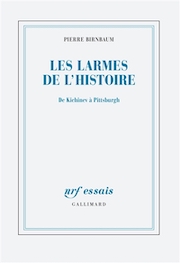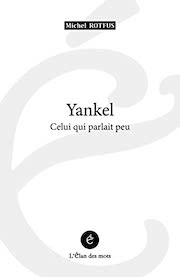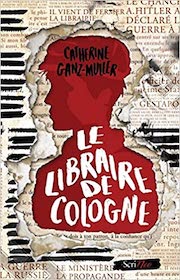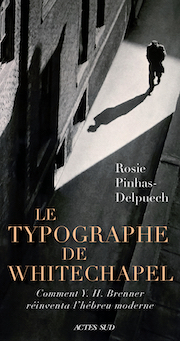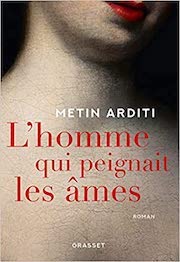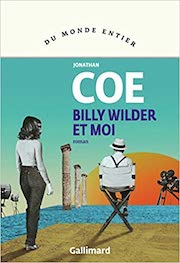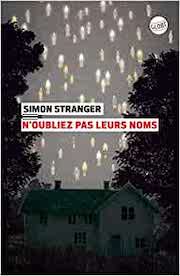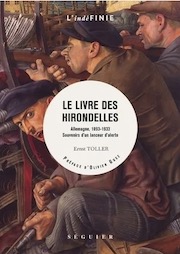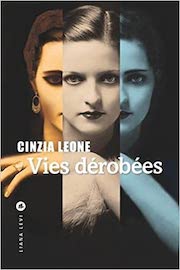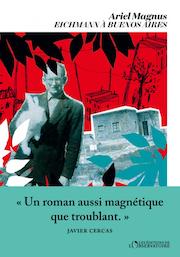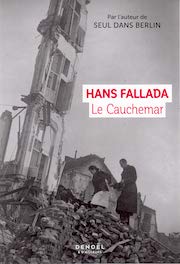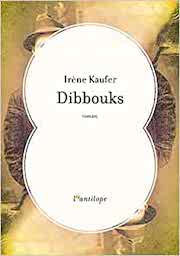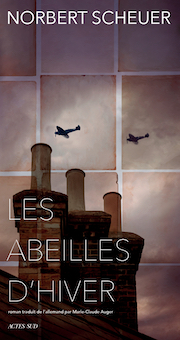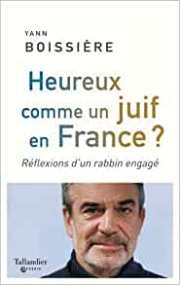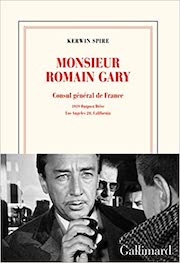ancre invisible changer l identifiant ID en ancre_X (x numéro du lien à créer)
LES PARTISANS – Kessel et Druon, une histoire de famille
Dominique Bona
Gallimard, 528 pages
Le livre débute avant la seconde guerre mondiale pour se prolonger tout au long du vingtième siècle et balaye l’ensemble de la vie politique de cette époque troublée : la Résistance, la guerre d’Algérie, la naissance d’Israël, De Gaulle, mai 68 …
Cette triple biographie se lit comme un roman policier. Dans cette “enquête”, l’auteure nous dévoile tout sur Joseph Kessel, son neveu Maurice Druon et Germaine Sablon, tous trois défenseurs acharnés de la France, résistants de la première heure.
Les deux premiers tiers de l’ouvrage sont consacrés à la description de leur vie: enfance, jeunesse, guerres, résistance, amours, amitiés, inimitiés…
À Londres, Joseph Kessel et Maurice Druon écrivent ensemble en 1943 – à partir d’une chanson russe d’Anna Marly – les paroles françaises de l’hymne de la Résistance, Le Chant des partisans.
On découvre aussi la vie de Germaine Sablon (soeur de Jean Sablon et maîtresse de Kessel), femme au parcours incroyable : chanteuse et combattante, figure indissociable de leurs destins entrecroisés, conductrice d’ambulance et aide infirmière sur les champs de bataille. Après la libération elle décorée de la médaille de la Résistance, de la croix de guerre et de la Légion d’honneur.
Le dernier tiers analyse les œuvres de Joseph Kessel et Maurice Druon et leurs liens familiaux marqués par la tendresse, la fidélité et la même passion : écrire. Kessel est déjà un écrivain connu quand Druon débute avec quelques grand succès littéraires. Ils ont vingt ans d’écart, et seront tous les deux élus à l’Académie française, aucun n’aura d’enfant.
Livre passionnant pour un retour au pays des grands hommes, sans oublier la femme qui va les accompagner un bout de chemin.
ancre invisible changer l identifiant ID en ancre_YYY (YYY numéro du lien à créer)
VOYAGE À REBOURS
Jacob Gladstein
L’Antilope, 345 pages.
Traduit du yiddish par Rachel ERTEL
1934. L’auteur, grand poète yiddish (1896-1971), embarque à New York sur un paquebot pour retourner vers sa ville natale de Lublin, au chevet de sa mère. Il prend le train au Havre, passe par Paris et retrouve des artistes à Montparnasse. En train, il traverse l’Allemagne, devenue nazie, avant d’arriver en Pologne où il n’est pas revenu depuis vingt ans.
Si le voyage en bateau constitue une « parenthèse enchantée » où, passager en classe de luxe, il s’amuse des conversations, jouit du spectacle de la comédie humaine cosmopolite dans un récit distancié, des échos de la catastrophe en marche l’alertent. Dans ce voyage vers l’enfance également, des souvenirs remontent – heureux (les séjours à Varsovie avec son grand-père) ou douloureux (« J’ai fui ma ville comme on fuit la peur. Un enfant juif est élevé dans la peur. » ; la cruauté des examinateurs avec le collégien juif ; le départ et l’arrachement à dix-huit ans…)
Le sentiment de solitude et l’angoisse s’accentuent à mesure qu’il traverse le pays et s’approche de sa maison : « Des masures à moitié effondrées. Des paysannes, pieds nus, tiennent des enfants dans leurs bras pour mendier. Du pain ! ». Le récit se fait plus sombre, plus profond, oscillant entre réalisme et onirisme.
La belle traduction de R. Ertel retranscrit bien le style vif et ironique de l’auteur, qui fut aussi journaliste – les brillants dialogues et descriptions, la vision lucide de la menace antisémite, les échanges entre Juifs et non-Juifs, la réflexion sur l’identité, la plongée dans les plis de la mémoire et du temps…
ancre invisible changer l identifiant ID en ancre_X (x numéro du lien à créer)
LE NAGEUR
Pierre Assouline
Gallimard, 256 pages
Pierre Assouline retrace dans son livre, Le Nageur, l’histoire bouleversante et le destin hors du commun d’Alfred Nakache, (surnommé Artem, poisson en hébreu).
Né à Constantine en 1915 dans un famille juive, Alfred Nakache va devenir un nageur d’exception, recordman du monde du 200 mètres brasse, quintuple champion de France et l’un des représentants/créateurs de la nage papillon, encore peu pratiquée et non homologuée à l’époque.
En 1936, il participe avec l’équipe de France aux jeux olympiques de Berlin et termine quatrième du relais 4 x 100 mètres nage libre, devant l’équipe allemande. Sur le podium, et pour signifier son opposition à Hitler, il baisse la tête pendant que les autres sportifs font le salut nazi. En 1942, il refuse de porter l’étoile jaune.
Réfugié en zone libre à Toulouse, il devient professeur d’éducation physique et continue à s’entraîner avec le club sportif “Les Dauphins”, grand pourvoyeur de champions français de natation. Alors que l’activité est interdite aux israélites, il enchaîne les compétitions et, la nuit, entraîne les résistants juifs.
Arrêté en 1943, sur dénonciation de son rival et collaborateur Jacques Cartonnet (si je le revois je le tue...phrase qui revient comme un fil conducteur dans le livre), il est déporté à Auschwitz, matricule 172763, avec sa femme et sa petite fille qui seront assassinées dès leur arrivée.
Transféré en janvier 1945 à Buchenwald, il survit mais revient terriblement diminué, ne pesant plus que 40 kg à sa libération. Après une période de profonde dépression, il réussit, grâce au soutien de sa famille et de son ancien entraîneur, Alban Minville, à renouer avec la natation et même à participer aux JO de Londres en 1948, douze ans après avoir concouru à ceux de Berlin…
Il meurt à 67 ans, à la suite d’un malaise alors qu’il nageait au large de Cerbère.
Le livre foisonne de détails passionnants : sur l’entraînement des nageurs, sur Pierre Mendès-France et les jeux de Berlin, sur la France de l’Occupation et le rôle du ministre des sports pétainiste, Jean Borotra, qui sera malgré tout l’un des protecteurs d’Artem, sur la Résistance juive dans la région toulousaine. Sur Auschwitz où sont décrits les combats de boxe qui y étaient organisés, (déportés contre kapos, voire soldats de la Wehrmacht, combats auxquels participa le champion du monde Young Perez).
Le Nageur n’est pas une biographie classique, c’est le récit d’une histoire singulière et passionnante dans l’ “Histoire”.
Une leçon de vie et de résilience.
De nombreuses piscines portent aujourd’hui le nom d’Alfred Nakache et d’Alban Minville, son entraîneur et ami.
LE BUREAU D’ÉCLAIRCISSEMENT DES DESTINS
Gaëlle Nohant
Grasset, 440 pages
Irène est embauchée à l’I.T.S. (International tracing Service), un centre de documentation sur les persécutions nazies.
En 2016, on lui confie une mission inédite : retrouver les héritiers des milliers d’objets dont le centre est dépositaire depuis la libération des camps. Chaque objet, même modeste, renferme ses secrets.
Elle se met à la recherche des descendants des déportés, propriétaires de ces objets. Au fil de ses enquêtes, Irène se heurte aux mystères du Centre et à son propre passé.
Sa quête va la conduire de Varsovie à Paris et Berlin, en passant par Thessalonique ou l’Argentine.
Le bureau d’éclaircissement des destins, c’est le fil qui unit ces trajectoires individuelles à la mémoire collective de l’Europe.
DE PITCHIK A PITCHOUK – Un Conte pour vieux enfants
Jean-Claude GRUMBERG
Seuil, 160 pages
Après le joyau de La plus précieuse des marchandises, on se demande dans quelle aventure nous embarque l’auteur, quel est ce Pitchik-Pitchok qui sonne à la fois comme Pitchoun et Pitchipoï (destination inconnue des convois de déportés), situé près de Brody, la ville de la famille maternelle de Grumberg. Quelle est cette histoire farfelue de vieille dame veuve devant sa cheminée Napoléon III d’où descend un Père Noël grognon, lui aussi esseulé, ayant perdu sa Mère Noël ?
Elle l’invite à un thé citron et le dialogue s’installe, loufoque, bourru : « Qu’est-ce que vous foutez là, nom de Dieu de nom de Diou ?! » – « J’ai un paquet à fourrer dans une godasse. »
Et la magie opère, entre humour et émotion, rêve et réalité. La trame du temps est bousculée, les lieux se télescopent…
Un patron de l’apprenti Grumberg avait raison : tu ne seras pas tailleur, mais plonge-toi dans les livres. Par le pouvoir des mots – cailloux contre l’oubli – , on vole en toute liberté, on se métamorphose telles des figures de Chagall, et les chers disparus sont ressuscités. On croise Charlot, des nazis, un colporteur (peut-être Mendele le marchand de livres de l’écrivain yiddish Sforim) assassiné par des cosaques, l’infirmière de l’Ehpad, le petit Jean-Claude caché et les enfants « étoilés » ; on assiste à la rencontre si poétique des grands-parents Baruch et Zina au square d’Anvers ; on devine Jacqueline, l’épouse décédée de l’auteur inconsolable. On parcourt les noms au cimetière de Bagneux. Une photo d’après la guerre expose des monceaux de cheveux, lunettes, chaussures (« Petit papa Noël, n’oublie pas leurs souliers. »)
La transmission est là encore au cœur du récit de J-C Grumberg, la révolte contre la haine, contre la barbarie (la guerre en Ukraine), avec l’injonction aux jeunes d’aimer et d’être heureux.
Vers la fin une jeune lectrice s’insurge : Vous êtes l’auteur ? Elle pointe les incohérences, l’épilogue ne lui plaît guère, et l’auteur s’exécute, revoit sa copie ! Sholem Aleichem lui aussi aimait malicieusement s’inviter dans ses romans et son théâtre…
FRANK KAFKA NE VEUT PAS MOURIR
Laurent Seksik
Gallimard, 352 pages
Le roman débute le 4 juin 1924 par un certificat constatant le décès le 3 juin 1924 du patient, Franz Kafka né le 3 juillet 1883 à Prague, travaillant au siège de l’office d’assurances contre les accidents du travail pour le royaume de Bohème. Le décès est lié aux suites d’une laryngite tuberculeuse fulminante ayant entraîné dénutrition et déshydratation.
« Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin » : telles sont les dernières paroles de Frank Kafka qui implore une autre dose de morphine à Robert Klopstock, son ami étudiant en médecine. A son chevet, sa compagne Dora Diamant veille sur lui. Tandis que Ottla sa sœur chérie attend des nouvelles à Prague.
Le livre se termine en 1972 et nous permet de suivre les destins entrecroisés de Robert, Dora, et Ottla.
Un des intérêts du livre, c’est l’étude minutieuse de ses trois personnages qui sont marqués au-delà de l’inimaginable par l’écrivain et par son œuvre.
Robert, jeune étudiant en médecine va rencontrer l’écrivain au sanatorium et va vite apprécier les textes que lui fait lire Franz, et qui le marquera sa vie durant.
Voilà l’opinion de Robert sur son grand ami : “Le petit agent d’assurances, fils soumis, fiancé asservi devenait un bâtisseur de mondes, un conquérant d’empires plus forts, plus puissants et plus immémoriaux que ceux d’Alexandre le grand, des empires du savoir et de la connaissance humaine qui avaient pour nom Le Procès, Le Château,L’Amérique.”
Robert deviendra, à News York, un éminent chirurgien de la tuberculose. Dora survivra à la persécution nazie, puis stalinienne et portera jusqu’à nous la mémoire de Franz Kafka. Ottla, accompagnera dans les chambres à gaz un groupe d’enfants juifs après avoir célébré, au camp de Theresienstadt, le soixantième anniversaire de la naissance de son frère.
L’auteur explore de manière inédite avec émotion et érudition l’œuvre de Kafka, en nous entraînant dans l’histoire tragique des juifs d’Europe Centrale.
Ce livre vous permettra de vous souvenir de tous les livres que vous avez lu de Kafka… ou dès le livre refermé vous plonger dans l’œuvre de ce grand écrivain.
Très belle lecture de ce livre qui ne vous laissera pas indifférent.
Livres recommandés en mai – juin
L’ ALLEMAND DE MA MERE
Catherine CLÉMENT
Seuil ,205 pages
Qui est le docteur Schütz, juif allemand réfugié à Paris, à qui la mère de la narratrice, jeune pharmacienne, vient en aide ? Quelle est la véritable identité de ce médecin qui se portera au secours de la famille de l’auteure durant toute la guerre ?
L’armée d’Hitler occupe la moitié du pays et les lois anti-juives se durcissent. La jeune mère et les siens doivent se cacher ; ils se réfugient dans le Maine-et-Loire, vers Saumur.
A l’heure de la Libération, tous n’auront pas la vie sauve. L’attente commence boulevard Raspail devant le Lutetia pour la jeune femme enceinte, accompagnée de sa fille.
Catherine Clément nous livre un récit intime, dépeignant ses parents qui « excepté leur âge et leurs études, n’avaient rien en commun », elle juive et lui issu d’une famille catholique. En contrepoint des souvenirs de sa petite enfance, la chronique historique se déroule, implacable – les décrets des nazis, la collaboration de Vichy, la traque des Juifs et le zèle de certains préfets, la délation au village, les assassinats de masse ; mais aussi la protection par des voisins, des sœurs au couvent…
Une œuvre de mémoire, sensible et précise, et d’histoire pour un rappel brut des faits.
LE DEPISTEUR
Antoine Ozanam (Scénario) – Marco Venanzi (Dessin)
GLÉNAT, 56 pages
La France dans les années 50 , la guerre est terminée mais la mission de Samuel ne fait que commencer.
C’est un dépisteur qui sillonne inlassablement la campagne français, c’est un ancien scout juif qui recherche les enfants cachés pendant la guerre dans des familles d’accueil
On le retrouve dans le Lot sur les traces d’une fillette qui avait un an en 1942, la famille qu’il recherche a été dénoncée pendant l’occupation.Aux dires d’un paysan tout le monde a été exécuté, mais personne ne se souvient de l’enfant caché.
Ce sont des rencontres fortuites qui guident les pas de Samuel et son propre passé mais tout le monde semble avoir quelque chose à cacher…
Dans ce premier tome qui nous laisse …. sur l’envie de connaître très vite la suite on se rend compte que tous les secrets ne sont pas bons à déterrer.
Bonne lecture.
ALORS VINT LA LUMIERE
Lea GOLDBERG
H et O, 254pages
(première édition en 1946)
Lea Goldberg est très populaire en Israël ; elle fait partie des auteurs de poésie et de livres pour la jeunesse. Ce roman réédité fut le premier roman écrit par une femme, édité en Israël. Suivi d’une courte biographie écrite par Olivier Bosseau, on y sent l’influence de la littérature russe, de Tchékov en particulier. Le personnage principal en est Nora, reflet de l’auteure.
Nora est en vacances dans la petite ville de son enfance, après un an d’études d’archéologie à l’université de Berlin. Elle y retrouve sa famille, ses relations, mais aussi l’atmosphère étouffante qu’elle avait fuie. Un personnage mystérieux, arrivé d’Amérique, ami de son père, fait son apparition ; Nora croit trouver en lui l’amour.
C’est en quelque sorte une vision romanesque de sa propre vie qui est mise en scène, bien que Lea Goldberg ait toujours refusé de parler d’autobiographie. Ce roman porte la marque de son temps, l’écriture est un peu datée, mais Nora, ses doutes, sa naïveté, sa fraîcheur, son goût pour la vie nous touchent par leur intemporalité.
RUSSES ET UKRAINIENS, LES FRERES INEGAUX du Moyen Age à nos jours
Andreas KAPPELER
CNRS éditions, 317 pages
Soirée au Centre Medem le 9 mai avec Denis Eckert (traducteur du livre)
Il est bien difficile de résumer le contenu de cet ouvrage historique, en raison des relations souvent équivoques entretenues par « les frères inégaux ». L’origine ambivalente de ces relations tenait à des problèmes ethniques, religieux, culturels, économiques qui remontent fort loin dans le temps.
Si l’on s’en tient à la période moderne, ce livre nous permet de comprendre que l’Occident a très longtemps ignoré cette partie de l’Europe orientale. Pour une raison simple : l’Ukraine était considérée comme une partie de l’Union soviétique, au même titre que les autres pays satellites, exception faite de la Pologne. Andreas Kappeler rappelle fort justement que les puissances occidentales craignaient le démantèlement de l’URSS (Kohl, Mitterrand et Bush).
De leur côté, les dirigeants russes (Gorbatchev, Eltsine) n’ont jamais envisagé une séparation de fait, même après avoir accordé l’indépendance en 1991 (Gorbatchev était même opposé à l’octroi de l’indépendance à l’Ukraine). Ils ont cru que l’Ukraine resterait dans le giron de la mère Russie. Or, les dirigeants ukrainiens (contrairement à la population) ont d’emblée établi une séparation véritable, un état de droit, une administration…
La population russe n’a jamais compris, encore moins admis cette fracture. En outre, si Poutine a repris le concept d’« empire russe » à son profit ce n’est pas seulement en raison de son passage au KGB : c’est aussi en raison de l’adhésion de la majeure partie de la population russe, unie à l’Ukraine de l’Est par une religion orthodoxe partagée. Les Ukrainiens étaient nommés « les petits Russes ». 2004 marque un tournant dans les relations entre les deux pays : c’est la révolution orange, place Maîdan. 2014 représente la première phase de l’envahissement de l’Ukraine : Poutine met la main sur la Crimée. L’Occident proteste verbalement, sans plus, laissant ainsi croire que l’Ukraine devrait se battre seule… On connaît la suite.
Dans sa conclusion, Kappeler rappelle que l’Ukraine n’a jamais renoncé à sa culture ruthène originelle, c’est-à-dire « la cosaquerie libre et égalitaire », page 278 ; que de son côté, la Russie post-soviétique n’a jamais accepté la perte de sa zone d’influence. Pour la première fois depuis longtemps, l’Ukraine est indépendante et se tourne vers l’Ouest. Il est temps pour les Occidentaux de l’aider à trouver sa place parmi les nations démocratiques. Il est temps pour la Russie de l’accepter.
HISTOIRE, MEMOIRES ET REPRESENTATIONS DES JUIFS D’ODESSA : un vieux rêve intime
Isabelle NÉMIROVSKI
Honoré Champion, 439 pages
Cet ouvrage, dense et exhaustif, retrace la vie de la population odessite, depuis la victoire de Catherine II de Russie sur les Turcs jusqu’à la fin du siècle dernier.
C’est en 1794 que la tsarine fonde la ville, sur les restes d’un village turc : Khadjibeï et de son fortin. Idéalement situé d’un point de vue russe, Odessa représente à la fois le « SUD » si attractif, et l’ouverture sur la mer. Dès l’origine, son éloignement de la capitale a attiré non seulement des Russes, mais aussi des immigrants très divers, lesquels en ont fait une ville cosmopolite. On peut souscrire à l’affirmation de l’auteur en faisant une ville quasi indépendante, voire rétive, dans laquelle règne une tolérance inconnue du monde russe.
Les juifs trouvent là un lieu propice à leurs aspirations de liberté et d’activité, si bien que la population juive grandit régulièrement et monte dans l’échelle sociale. L’apogée de cette réussite se situe à la fin du 19e siècle : les juifs se distinguent dans les banques, dans les arts et la culture : dans l’index figurent des noms très célèbres qui firent la gloire d’Odessa. Tant et si bien que cette ville acquiert progressivement le statut d’un mythe, surtout aux yeux de ceux qui en sont partis !
Ce livre très riche est captivant, même pour les lecteurs qui ne sont pas originaires de la ville : en effet, il retrace le parcours de tous ces juifs qui ont œuvré pour la gloire de leur ville, sans savoir qu’un jour, ils devraient la quitter, pourchassés à la fois par la Russie et par l’Allemagne nazie.
Odessa saura-t-elle se souvenir d’eux ?
SPIROU – L’ESPOIR MALGRÉ TOUT
Quatrième partie : UNE FIN ET UN NOUVEAU DÉPART
ÉMILE BRAVO (Textes et dessins)
DUPUIS, 48 pages
Été 1944, la guerre est entrée dans sa phase finale avec la bataille de Normandie. Fantasio et Spirou assistent à l’explosion du train de soldats allemands (c’est l’écureuil Spip qui a appuyé sur le détonateur !) mais ne peuvent empêcher le départ du dernier convoi de déportés vers l’Est.
Dans Bruxelles en liesse avec l’arrivée des Anglais, c’est aussi l’heure des règlements de comptes : collaborateurs, certains policiers et prêtres délateurs, responsables scouts de la VNV (ligue nationaliste flamande), vrais résistants et résistants de la dernière heure…
Quelques mois plus tard, des déportés reviennent, méconnaissables, comme le directeur de l’hôtel maintenant en ruines. Kassandra, la fiancée de Spirou rescapée des camps, part finalement en Palestine où sera fondé un Etat juif. Felix et Felka ne sont pas revenus d’Auschwitz. (La page de fin reproduit l’impressionnant dernier tableau de Felix Nussman – Le Triomphe de la mort.)
Dans l’épilogue, la vie recommence. Les deux amis repartent à bicyclette vers l’aventure, Fantasio optimiste et blagueur, heureux d’être embauché au sein de nouvelle rédaction du journal et fier d’être proposé pour la Croix de guerre, Spirou plus soucieux quant à l’avenir : « La bête n’est pas morte ».
Ainsi se clôt la série consacrée à la Shoah. La fantaisie est toujours là sous la gravité et le tragique.
Le lecteur pourra se documenter sur des thèmes abordés au fil des volumes : les trois jeunes gens qui ont arrêté le convoi 20 du 19 avril 1943 et permis à des déportés de s’échapper ; le gouvernement en exil et l’attitude controversée de Léopold III ; la question de la colonisation du Congo belge…
SPIROU – L’ESPOIR MALGRÉ TOUT
Troisième partie : UN DÉPART VERS LA FIN
ÉMILE BRAVO (Textes et dessins)
DUPUIS, 112 pages
Belgique, été 1942. Du train en partance vers la Pologne, Spirou parvient à sauter avec ses jeunes protégés, Suzanne et P’tit Louis, qu’il va cacher dans une ferme près de Namur.
Entre Bruxelles et la campagne, allers-retours à moto, vélo, camion de lait, automobile à gazogène, Spirou et Fantasio se dépensent pour aider des enfants juifs, ravitailler dans leur planque leurs amis Felix et Felka, trouver des faux-papiers, passer des armes… Ils poursuivent leurs spectacles de marionnettes (telles les tournées de Jean Doisy, directeur du Journal de Spirou, interdit par les Allemands, qui permettait à des résistants de voyager en Belgique occupée).
Les événements se succèdent au fil des mois : débarquement des Alliés en Afrique du Nord, défaite du Reich à Stalingrad, attentat contre Hitler, gouvernement belge en exil à Londres, débarquement en Normandie…
A la face sombre – tortures en prison, morts, lourds cas de conscience (tuer des collaborateurs, des soldats nazis) – répondent l’espoir toujours présent, les valeurs de fraternité du « code d’honneur », et l’humour, la loufoquerie de Fantasio, les clins d’œil (le peintre René Magritte croisé au marché). Les deux héros, bien incarnés, ressentent empathie, peine, émois amoureux, jalousie.
Le volume laisse le lecteur en plein suspense : Fantasio fera-t-il sauter le train « prioritaire » de déportés juifs vers l’est, qu’il pense être un convoi militaire allemand ?
* Le podcast très éclairant du commissaire de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah au Mémorial, D. Pasamonik, 2023, nous en apprend plus sur l’action des grands résistants belges Jean Doisy et Suzanne Moons (qui ont sauvé des centaines d’enfants juifs), sur les peintres Felix Nussbaum et Felka Platek assassinés à Auschwitz. « Toute la vertu d’É. Bravo est d’allier la fiction et la réalité, le tragique et le léger. Cette œuvre de transmission, qui décrit le processus génocidaire de manière non angoissante, est un support de dialogue pour expliquer la Shoah aux plus jeunes. »
Nos sélections récentes
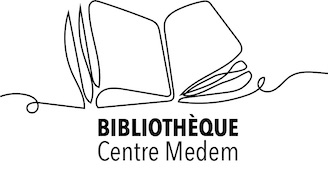
Et aussi les plus anciennes sélections de la bibliothèque